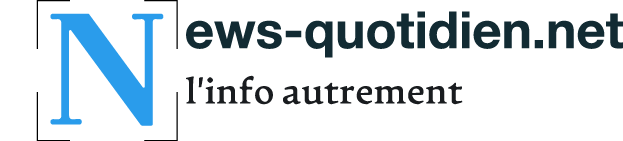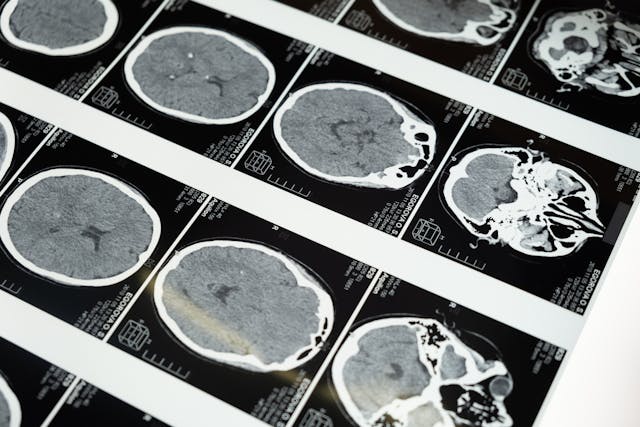C’est une histoire qui semble tout droit sortie d’un roman de science-fiction. Après près de deux décennies de silence, une femme canadienne de 47 ans, rendue muette et tétraplégique par un AVC survenu à l’âge de 30 ans, a retrouvé la capacité de s’exprimer grâce à un dispositif d’intelligence artificielle directement connecté à son cerveau. Cette avancée spectaculaire ouvre une nouvelle ère dans la prise en charge des troubles de la communication liés à des lésions neurologiques.
Quand la technologie donne une voix au silence
Le projet, mené par des chercheurs des universités de Berkeley et de San Francisco, repose sur un implant cérébral capable d’interpréter les signaux neuronaux associés à la parole. L’appareil, placé sur la surface du cortex cérébral, enregistre l’activité neuronale quand la patiente tente de parler mentalement. Ces signaux sont ensuite traduits en paroles audibles grâce à un modèle d’intelligence artificielle entraîné à reconnaître plus d’un millier de mots. L’originalité de cette technologie réside dans sa capacité à fonctionner en temps réel, sans attendre la fin d’une phrase pour en produire la transcription. Chaque fragment de pensée est immédiatement décodé et transmis, permettant une conversation plus fluide que les systèmes de communication précédents, qui souffraient de délais de plusieurs secondes.
Autre prouesse : le système ne se contente pas de générer des mots. Grâce à d’anciens enregistrements de la patiente avant son AVC, les chercheurs ont pu entraîner un synthétiseur vocal à reproduire le timbre et l’intonation de sa voix d’origine. C’est donc bien elle que l’on entend, ou plutôt, une version numérique de la voix qu’elle avait perdue. Un détail qui, au-delà de l’émotion qu’il suscite, représente une avancée majeure sur le plan psychologique et identitaire.
Un outil encore en perfectionnement
Pour l’instant, le vocabulaire reste limité à un lexique de 1 024 mots, mais les performances sont déjà remarquables : le système atteint un taux de reconnaissance de près de 80 %. Les chercheurs envisagent d’élargir la base lexicale, d’améliorer la fluidité des échanges et d’adapter le dispositif à d’autres pathologies, comme la sclérose latérale amyotrophique (SLA) ou les suites de traumatismes crâniens. Le Dr Gopala Anumanchipalli, co-auteur de l’étude publiée dans Nature Neuroscience, résume ainsi l’ambition du projet : « Il ne s’agit pas seulement de redonner la parole. Il s’agit de redonner à ces personnes un moyen d’exister dans le monde, de participer aux échanges, de prendre des décisions, de vivre pleinement. »
Cette avancée technologique pose aussi des questions fondamentales : à qui s’adresse-t-elle ? Quel sera son coût ? Et surtout, comment encadrer son usage ? Pour les chercheurs, l’enjeu est clair : développer une technologie accessible et respectueuse de l’autonomie des patients. Pour la patiente, ancienne enseignante, ce nouveau souffle donne un sens inattendu à son avenir. Elle envisage désormais de reprendre une activité professionnelle, peut-être comme conseillère d’orientation. Mais plus encore, elle peut à nouveau rire, exprimer ses émotions, dire « je t’aime » à ses proches – autant de choses simples devenues soudain extraordinaires après tant d’années de silence.