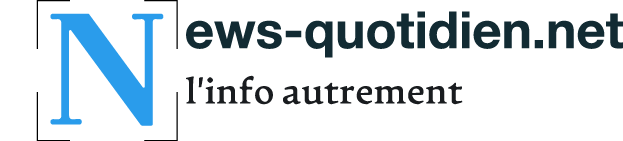Après des années de débats, le Parlement adopte une réforme historique qui inscrit enfin le non-consentement dans la définition pénale du viol et des agressions sexuelles.
C’est une phrase simple, mais son poids juridique est immense. Désormais, en France, « tout acte sexuel non consenti » est considéré comme un viol ou une agression sexuelle. Mercredi 29 octobre, le Parlement a définitivement adopté la proposition de loi portée par Marie-Charlotte Garin (écologiste, Rhône) et Véronique Riotton (Renaissance, Haute-Savoie). Le Sénat l’a validée à une très large majorité (327 voix pour, 15 abstentions), après un vote déjà quasi unanime à l’Assemblée nationale. Une « victoire historique », selon ses initiatrices, qui saluent « une avancée majeure pour bâtir une culture du consentement ».
Une réforme attendue de longue date
Jusqu’à présent, la loi française ne définissait le viol et les agressions sexuelles qu’à travers les notions de « violence », « contrainte », « menace » ou « surprise ».
Une formulation jugée obsolète, source de nombreux classements sans suite dans les plaintes pour viol, faute de pouvoir prouver la contrainte physique. Désormais, la loi intègre la notion de non-consentement et précise la définition juridique du consentement, qui devra être « libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable ».
Il « ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime » et « il n’y a pas de consentement si l’acte sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature ».
Ce changement législatif marque un tournant symbolique et culturel. « Nous vivons depuis des siècles dans la culture du viol. Commençons à construire la culture du consentement », a plaidé la sénatrice écologiste Mélanie Vogel lors des débats.
« Quand vous ne dites pas oui, c’est non. Quand vous dites oui parce que vous avez peur, c’est non. Le seul oui qui vaille, c’est un oui libre. » La France rejoint ainsi plusieurs pays ayant déjà inscrit le consentement dans leur droit pénal : le Canada, la Suède, l’Espagne, ou encore la Norvège, pionnière en Europe depuis le printemps 2025.
Un texte soutenu par le gouvernement
Le texte a été soutenu par le garde des Sceaux Gérald Darmanin et par la ministre déléguée aux Droits des femmes, Aurore Bergé, qui y ont vu « un outil essentiel pour mieux protéger les victimes et clarifier les enquêtes ». Pour Isabelle Rome, ancienne ministre chargée de l’Égalité femmes-hommes et magistrate, il s’agit d’une « victoire de la liberté sur l’oppression » : « Cette loi changera le cours des enquêtes et permettra d’obtenir plus de poursuites et plus de condamnations. Elle fait peser sur le mis en cause la responsabilité de s’assurer du consentement de l’autre. »
Certains élus ont néanmoins exprimé leurs réserves. La députée RN Sophie Blanc a dénoncé un texte qui, selon elle, « fera peser le doute sur chaque geste et chaque mot » lors des procès. D’autres, comme la sénatrice socialiste Laurence Rossignol, regrettent l’usage du mot “consentement”, estimant qu’il reste « marqué par une vision archaïque de la sexualité, où les femmes cèdent ou se refusent ». « Consentir n’est pas vouloir », a-t-elle rappelé sur X (ex-Twitter). Malgré ces divergences, une majorité de parlementaires a salué un texte équilibré, conforté par un avis favorable du Conseil d’État en mars dernier.
Vers une évolution des mentalités
Du côté des associations, la satisfaction se mêle à la prudence. « C’est un pas historique, mais pas une baguette magique », prévient Lola Schulmann, chargée de plaidoyer chez Amnesty International France. « Cette loi ne suffira pas sans une réelle éducation à la vie affective et sexuelle, et sans la formation des magistrats et policiers. » Même son de cloche à la Fédération nationale des centres d’information sur les droits des femmes et des familles (FNCIDFF), qui insiste sur la nécessité d’un accompagnement éducatif massif pour ancrer cette nouvelle définition dans la société.
Quelques mois après le procès des viols de Mazan, où le débat sur le consentement avait révélé les zones grises du droit, cette réforme s’inscrit dans un climat de prise de conscience collective. Elle vise à rendre la loi plus claire, plus protectrice, mais aussi à rappeler une évidence : l’absence de “non” n’a jamais signifié un “oui”.