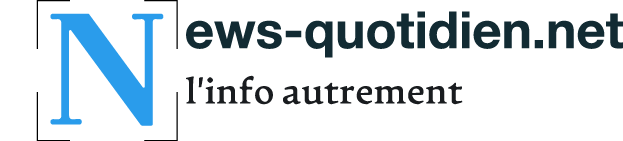L’hostilité entre l’Inde et le Pakistan ne date pas d’hier. Les deux pays sont nés en 1947 lors de la partition sanglante de l’Empire britannique des Indes, qui a provoqué des millions de morts et de déplacés. Depuis, trois guerres ont été menées (1947, 1965 et 1971), sans compter les nombreux accrochages militaires, notamment dans la région disputée du Cachemire. Ce territoire montagneux, à majorité musulmane mais en grande partie contrôlé par l’Inde, est le cœur du contentieux. Les deux pays le revendiquent et y entretiennent une forte présence militaire. Depuis la révocation de l’autonomie du Jammu-et-Cachemire par l’Inde en 2019, les tensions ont encore gagné en intensité.
Une escalade verbale et militaire inquiétante
Depuis avril 2025, la situation s’est tendue à nouveau après plusieurs échanges de tirs à la frontière et des déclarations musclées de part et d’autre. Le 18 avril, l’Inde a accusé le Pakistan d’avoir soutenu une tentative d’infiltration terroriste dans le district de Poonch, au sud du Cachemire. Islamabad a immédiatement nié, dénonçant une « opération sous faux drapeau » orchestrée par New Delhi.
En réponse, l’Inde a renforcé sa présence militaire dans la région, tandis que le Pakistan a mobilisé ses troupes le long de la Ligne de Contrôle (LoC), la frontière de facto au Cachemire. Des drones de surveillance ont été abattus de part et d’autre, ravivant les craintes d’un affrontement plus large. Parallèlement, le Premier ministre indien Narendra Modi a durci son discours à l’approche des élections générales de mai 2025, promettant de « répondre avec force à toute agression ». Son homologue pakistanais Shehbaz Sharif a répliqué que le Pakistan « ne se laisserait pas intimider ».
La carte du nationalisme et l’effet des élections
Cette nouvelle flambée des tensions coïncide avec un contexte électoral tendu en Inde. Le Bharatiya Janata Party (BJP) de Modi joue la carte du nationalisme et de la fermeté sécuritaire pour galvaniser son électorat. Selon plusieurs analystes, une posture agressive face au Pakistan est politiquement payante. Du côté pakistanais, où l’économie est en crise et la stabilité politique fragile, les militaires – qui gardent une forte influence sur les affaires étrangères – n’ont aucun intérêt à apparaître faibles. Les déclarations belliqueuses participent ainsi à un double jeu interne : mobilisation nationale et diversion.
Les États-Unis, la Chine et les Nations unies ont exprimé leur inquiétude face à cette montée des tensions. Le Conseil de sécurité de l’ONU a appelé à la « désescalade immédiate » et proposé une médiation. Washington a exhorté les deux pays à « faire preuve de retenue », redoutant un affrontement entre deux puissances nucléaires. La Chine, alliée du Pakistan mais partenaire économique de l’Inde, joue un rôle ambivalent, appelant publiquement au calme tout en renforçant sa propre présence militaire dans la région de l’Himalaya.
Une paix possible ?
Malgré la rhétorique guerrière, plusieurs signaux montrent qu’un conflit ouvert reste peu probable : l’interdépendance économique régionale, la pression internationale et le risque de débordement nucléaire constituent des freins majeurs. Mais le danger réside dans l’escalade non contrôlée, où un incident local pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Le dialogue bilatéral, interrompu depuis 2019, pourrait reprendre après les élections indiennes. Des émissaires non officiels seraient déjà en contact, selon des sources diplomatiques citées par The Hindu. Reste à savoir si la volonté politique suivra.