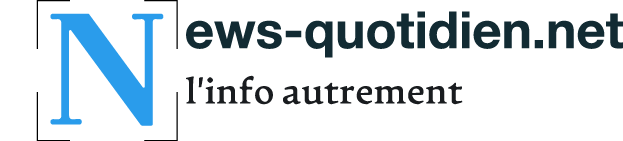Au large des côtes françaises, des images récentes font polémique : des agents de la Compagnie de Marche sont descendus en mer pour percer les embarcations gonflables des migrants tentant de traverser la Manche. Cette nouvelle stratégie intervient dans la perspective d’un sommet franco-britannique apte à activer un accord bilatéral « retour un contre un » — un tournant significatif dans la coopération migratoire entre les deux pays. Face à une hausse de 47 % des traversées cette année, le Royaume-Uni met la pression, tandis que la France justifie une intensification des mesures dans une mer jusque-là « hors limites ». Entre efficacité opérationnelle et critiques humanitaires, cette initiative soulève des questions légales, éthiques et politiques.
Une tactique offensive en pleine mer : étendre la doctrine migratoire
Dans un passage rapporté par The Times, des policiers de la Compagnie de Marche, équipés de couteaux, sont intervenus dans des eaux peu profondes pour perforer les caoutchoucs des RIB migrants en train d’embarquer. Ce geste, techniquement audacieux, est présenté comme un préalable à une modification des lois maritimes, actuellement en débat parlementaire. Si elle est approuvée, cette modification autoriserait légalement les forces françaises à opérer en mer ouverte, transformant un acte qualifié de « vigoureux » en stratégie officiellement sanctionnée.
Mais dans les méandres juridiques et politiques, cette mesure dévoile des fractures. À l’aube d’un sommet France–Royaume-Uni, le président Macron et le ministre Retailleau pourraient acter un partenariat renforcé – incluant potentiellement des retours systématiques de migrants. Londres, emmené par la ministre Yvette Cooper, salue ce durcissement – estimant que sans actions coordonnées et fermes, la crise ne faiblira pas . En face, plusieurs ONG et États méditerranéens s’indignent, dénonçant un risque d’augmentation des drames en mer et une mise en péril du droit humanitaire.
Effets et limites : entre dissuasion et dérives opérationnelles
Depuis la mise en place de cette tactique, les retombées sont mitigées. D’un côté, les autorités britanniques et françaises rapportent une baisse des embarcations arrivantes — signe que la mesure aurait un effet dissuasif immédiat. De l’autre, des éléments problématiques émergent : la division des pratiques policières, certains groupes escortant encore les migrants dans les eaux britanniques témoigne d’une incohérence. Par ailleurs, les risques pour la sécurité des migrants — embarcations éventrées, noyades, équipements de sauvetage non fonctionnels — relancent le débat sur l’équilibre entre lutte migratoire et devoir de secours.
Enfin, le débat politique est en surchauffe à Londres, où Cooper propose une radicalisation des sanctions : retrait du logement aux migrants travaillant illégalement, poursuites en cas de décès en mer malgré la traversée, et accélération des procédures d’asile . Ces mesures radicales interrogent la capacité du Royaume-Uni à traiter le phénomène face à une Union européenne en ordre dispersé, où chacun redoute que l’accord bilatéral franco-britannique ne serve de précédent.
L’usage de couteaux pour crever les bateaux de migrants marque un moment charnière dans la politique migratoire européenne. Plus qu’une mesure tactique, elle représente un point de bascule : traverser la Manche est désormais une démonstration concrète de force sécuritaire. Reste à savoir si cette offensive maritime émergera comme modèle, ouvrant la voie à des règles dures — ou si elle se heurtera aux principes humanitaires et à l’inefficacité que dénoncent certains acteurs.
Ce dossier évoque bien plus que des méthodes policières : il révèle les tensions entre coopération internationale, droits humains et crises migratoires. Dans un contexte de pression migratoire croissante, le sommet de la semaine prochaine sera certainement l’occasion de préciser un tournant potentiel : vers des routes plus sûres… ou vers des eaux plus fermées.