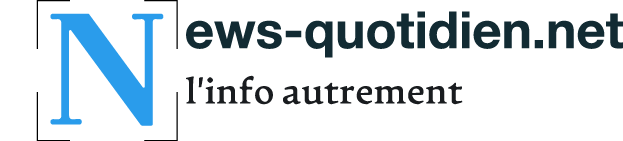Une journée historique pour le Proche-Orient.
Ce lundi 13 octobre, Israël a libéré 1 968 prisonniers palestiniens en échange des 20 derniers otages israéliens encore en vie détenus par le Hamas.
Une étape majeure du cessez-le-feu conclu sous médiation internationale, saluée comme une « victoire » par le mouvement palestinien, mais accueillie avec prudence à Jérusalem
Un échange d’ampleur inédite
Dans un communiqué diffusé lundi matin, l’administration pénitentiaire israélienne a annoncé avoir procédé à la libération de 1 968 prisonniers palestiniens, détenus pour des faits qualifiés de « terroristes » par Israël. Ces détenus ont quitté les prisons d’Ofer (Cisjordanie occupée) et de Ktziot (sud d’Israël), avant d’être acheminés vers Gaza, Jérusalem-Est et plusieurs villes palestiniennes.
Cette mesure s’inscrit dans le cadre du cessez-le-feu global signé entre Israël et le Hamas, qui prévoit la libération de tous les otages israéliens encore détenus dans la bande de Gaza en échange de plusieurs centaines de prisonniers palestiniens incarcérés pour des « raisons de sécurité », ainsi que des 1 700 Palestiniens arrêtés depuis le début de la guerre en octobre 2023.
Le retour des 20 derniers otages israéliens vivants
En parallèle, les 20 Israéliens encore en vie — civils et militaires — ont été remis dans la matinée à la Croix-Rouge internationale, avant leur transfert vers Israël. Ces libérations concluent un long processus de négociation mené par le Qatar, l’Égypte, la Turquie et les États-Unis, dans le cadre de l’accord de paix signé la semaine dernière. Parmi les otages libérés figurent notamment Eitan Mor (25 ans), vigile au festival Nova, les jumeaux Gali et Ziv Berman (28 ans), producteurs de musique enlevés à Kfar Aza, ou encore Matan Angrest (22 ans), jeune sous-officier capturé dans son char à la frontière de Gaza. Tous ont passé près d’un an en captivité, dans des tunnels souterrains, dans des conditions que les médecins israéliens qualifient de « précaires et traumatisantes ». Pour l’heure, seuls quatre des vingt-huit corps d’otages décédés ont été restitués à Israël, selon la Croix-Rouge.
À Gaza, la libération des prisonniers palestiniens a donné lieu à des scènes de liesse.
Des foules se sont rassemblées dans plusieurs quartiers de Khan Younès et Rafah pour accueillir les libérés. Dans un communiqué, le Hamas a salué une « réussite nationale » et une « victoire sur le chemin de la libération totale ». Plusieurs anciens détenus sont des figures du mouvement, condamnées pour des attentats meurtriers commis lors des deux dernières décennies. Selon les autorités israéliennes, parmi les prisonniers relâchés figurent notamment Abdel Rahman Shalabi, condamné en 2002 pour tentative d’attentat à Jérusalem, et Sami Al-Masri, détenu depuis 2005 pour appartenance au Jihad islamique. Si ces libérations sont présentées par le Hamas comme une victoire morale, elles suscitent l’inquiétude d’une partie de l’opinion israélienne, pour qui un tel échange « renforce les organisations terroristes » et affaiblit la dissuasion nationale.
Trump proclame « la fin de la guerre »
Quelques heures après l’échange, Donald Trump, revenu à la Maison-Blanche depuis janvier, a affirmé que « la guerre est terminée », avant de s’envoler pour une tournée diplomatique en Israël et en Égypte. « Ce sera un moment très spécial », a-t-il déclaré aux journalistes avant son départ, ajoutant que l’accord allait « tenir ». Lors d’une brève cérémonie à Charm el-Cheikh, l’ancien président américain a signé, avec l’Égypte, le Qatar et la Turquie, une déclaration commune sur Gaza, censée « détailler les règles et les dispositions » du cessez-le-feu et du futur plan de reconstruction. Son administration espère faire de ce texte la base d’un processus politique durable, articulé autour d’un plan de sécurité pour Gaza, d’un mécanisme de supervision internationale et d’un engagement financier pour la reconstruction de l’enclave.
À Jérusalem, le Premier ministre Benyamin Netanyahou a salué « d’immenses victoires » qui « ont stupéfié le monde entier », tout en soulignant que « la lutte n’est pas terminée ». Dans une allocution télévisée, il a appelé à la vigilance et à la « préparation face à toute nouvelle menace ». Selon le gouvernement israélien, le retour des otages — vivants ou morts — constitue la première étape du plan de cessez-le-feu, qui prévoit aussi la libération progressive de 250 détenus palestiniens condamnés pour des attentats, et l’allègement partiel du blocus sur Gaza. « Nous avons obtenu le retour de nos citoyens, mais notre sécurité reste non négociable », a déclaré un porte-parole du gouvernement.
Une paix encore sous tension
Malgré la portée symbolique de cet échange, les divisions persistent.
Les négociateurs égyptiens et qataris redoutent des violations du cessez-le-feu dans les prochains jours, tandis que plusieurs factions armées palestiniennes non alignées au Hamas refusent encore de déposer les armes. Pour les familles israéliennes, la libération des otages n’efface ni la douleur, ni la colère : plus de 1 200 Israéliens ont été tués lors des attaques du 7 octobre 2023, et plus de 40 000 Palestiniens ont péri dans la guerre, selon les autorités locales et les ONG humanitaires.
La signature de la déclaration de Charm el-Cheikh marque une rare convergence diplomatique. Autour de la table : les États-Unis, l’Égypte, le Qatar, la Turquie, mais aussi, par visioconférence, la France et l’Union européenne, invitées en observatrices.
Emmanuel Macron, présent au Caire, a salué un « pas décisif vers la paix », tout en appelant à « la reconstruction de Gaza dans la sécurité et la dignité ». Sur le plan intérieur israélien, cette libération pourrait rebattre les cartes politiques. Affaibli par une année de guerre, Benyamin Netanyahou sort renforcé sur la scène diplomatique, mais fragilisé sur le plan intérieur : la société israélienne reste profondément divisée sur la manière d’aborder la question palestinienne.
Entre paix fragile et mémoire douloureuse
La libération des otages et des prisonniers met fin à un cycle d’un an de guerre, mais ne scelle pas encore la réconciliation.
À Tel-Aviv comme à Gaza, les images de liesse se mêlent à celles des enterrements et des ruines. Pour certains, comme Eitan Mor ou Matan Zangauker, ce retour est celui de la survie. Pour d’autres, il reste celui de l’absence : des centaines de familles israéliennes n’ont toujours pas retrouvé leurs proches disparus.
À Gaza, des mères palestiniennes brandissent le portrait de leurs fils libérés, mais redoutent déjà les représailles, les reconstructions sans lendemain, et la lenteur d’une paix souvent promise, rarement tenue.