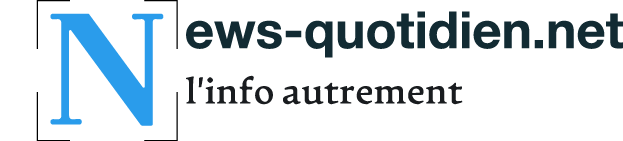Le 23 novembre 2025 marque un tournant décisif dans le secteur viticole français : des milliers de vignerons entament un nouveau week-end de mobilisation, entre manifestations sur les places publiques, barrages routiers et revendications pressantes auprès du gouvernement. Après des années de sécheresses, de canicules répétées, et de baisse des rendements, la filière vinicole – patrimoine économique et culturel majeur – est secouée par une colère profonde. Les viticulteurs réclament des aides d’urgence, des allègements fiscaux, mais aussi une reconnaissance que le changement climatique bouleverse durablement leurs pratiques. Cette fronde pourrait bien être l’un des mouvements agricoles les plus structurés depuis la grande crise du monde rural : un bras de fer entre l’État, la tradition viticole et l’adaptation climatique.
1. Une mobilisation massive pour protéger l’économie viticole
Depuis le début de la semaine, les syndicats de vignerons (FNSEA Vigne, Vignerons indépendants, producteurs coopérateurs) ont appelé à des rassemblements dans les principales régions viticoles : Bordeaux, la Champagne, la Bourgogne, mais aussi dans le Languedoc et le Rhône. Le 23 novembre, des cortèges sont prévus dans plusieurs villes, et certains producteurs bloquent les routes d’accès aux châteaux ou aux caves coopératives, exigeant du gouvernement des engagements clairs. Entre les rangs de vignes desséchées, les professionnels dénoncent la double peine : des récoltes en berne et des prix trop faibles, qui ne compensent pas les pertes de production. Le manque de revenus menace non seulement l’activité agricole, mais aussi l’emploi local et la survie de nombreux domaines viticoles familiaux.
Les protestataires réclament en priorité deux types d’aide : une aide d’urgence immédiate — fondée sur des subventions à la distillation, des primes au maintien de la vigne, ou des prêts bonifiés — et un plan à long terme pour adapter la viticulture au réchauffement climatique. Certains vignerons demandent la création d’un “fonds climat vigne”, financé par l’État et l’Europe, pour financer la replantation de souches plus résistantes à la chaleur, la rénovation des systèmes d’irrigation et la recherche sur des techniques de viticulture nouvelle génération. Sur les réseaux sociaux, le hashtag #VigneEnColère gagne en traction, relayant des vidéos de rangs désertés, de tonneaux vides et d’apels à la solidarité national.
2. Le gouvernement face au dilemme : soutien ou restructuration ?
De son côté, le gouvernement se retrouve sous pression. Le ministère de l’Agriculture a exprimé sa “compréhension” face aux difficultés, mais tempère en soulignant que les aides ne peuvent pas être « illimitées ». Une réunion d’urgence a été convoquée avec les représentants des producteurs, mais plusieurs vignerons dénoncent un manque de visibilité sur les engagements à venir. Certains ministres évoquent la nécessité d’un “virage structurel” : non seulement soutenir les viticulteurs, mais les encourager à repenser leurs modèles de production dans un climat qui change trop rapidement. Une telle vision suscite l’inquiétude chez ceux qui craignent que la viticulture traditionnelle, comme celle des cépages anciens ou des domaines familiaux, soit sacrifiée au profit de solutions intensives ou trop technologiques.
Par ailleurs, la pression européenne se fait sentir : Bruxelles pourrait conditionner certaines aides (PAC) à des investissements “verts” ou à des projets de durabilité. Plusieurs agronomes alertent que sans un accompagnement fort, la filière risque de s’effondrer ou de se scinder entre producteurs “modernistes” (prêts à investir dans l’innovation) et vignerons plus traditionnels, incapables de financer le virage. Le 23 novembre, des voix s’élèvent pour appeler à un “plan Marshall de la vigne”, concept associant fonds publics, prêts subventionnés, et partenariats privés pour sauver l’un des symboles de l’économie et de la culture française.
Le 23 novembre 2025 pourrait bien entrer dans l’histoire viticole de la France comme le jour où la filière a exigé non seulement des aides, mais une stratégie de survie face à un climat en mutation. La mobilisation des vignerons traduit la douleur d’un secteur en crise mais aussi une volonté farouche de se réinventer.
Le défi pour le gouvernement est double : répondre aux urgences économiques tout en initiant un changement durable, sans briser l’identité profonde de la viticulture française. Entre soutien immédiat et planification à long terme, l’avenir de la vigne tricolore semble suspendu à une décision politique lourde de sens.