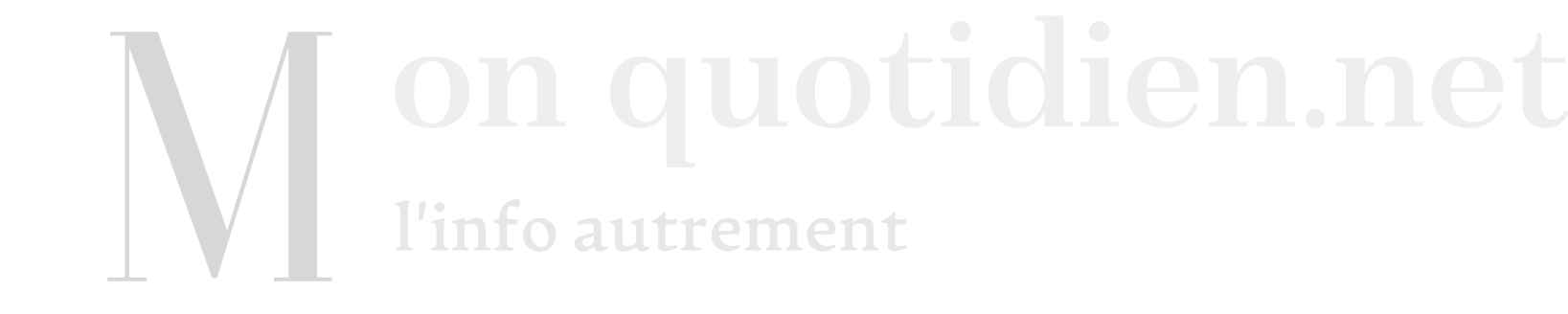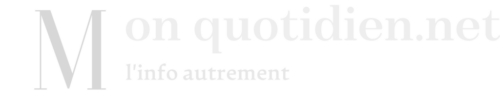Elle condamne la France pour violation du droit à la vie , mettant en cause l’usage disproportionné de la force par les forces de l’ordre lors du maintien de l’ordre à Sivens. Un arrêt qui marque une nouvelle étape dans une affaire qui, jusqu’ici, n’avait débouché sur aucune condamnation pénale.
Un combat judiciaire de dix ans pour obtenir justice
L’affaire remonte à la nuit du 25 au 26 octobre 2014 , lors d’une manifestation contre le projet de barrage de Sivens , dans le Tarn . Rémi Fraisse, alors âgé de 21 ans, est mort après l’explosion d’une grenade offensive OF-F1 , lancée par un gendarme mobile. Son décès avait provoqué une vague d’indignation et relança le débat sur la gestion du maintien de l’ordre en France. Pourtant, malgré plusieurs recours judiciaires, aucune mise en examen n’avait été prononcée contre le gendarme auteur du tir ni contre sa hiérarchie. L’enquête judiciaire s’était soldée par un non-lieu définitif en 2018, et la justice administrative avait certes reconnu la responsabilité civile de l’État en 2023, mais sans retenir de faute commise.
La CEDH vient donc rompre avec cette impunité , en constatant des manquements graves dans l’encadrement des forces de l’ordre et dans l’utilisation d’armes potentiellement mortelles. Selon les juges européens, « le niveau de protection requis » pour prévenir un usage disproportionné de la force n’a pas été garanti ( arrêt de la CEDH, 27 février 2025 ).
Un usage disproportionné de la force et une chaîne de commandement défaillante
L’arrêt de la CEDH pointe plusieurs lacunes graves dans la gestion des opérations de maintien de l’ordre à Sivens. Parmi elles :
- L’absence d’un cadre strict pour l’usage de la grenade OF-F1, une arme contenant du TNT , jugée particulièrement dangereuse.
- Le manque d’encadrement des forces de l’ordre sur le terrain : aucune autorité civile n’était présente au moment des affrontements.
- Un commandement déficient , incapable d’évaluer la gravité de la situation et le risque de dommages irréversibles.
« La grenade OF-F1 était problématique en raison de l’absence d’un cadre d’emploi précis et protecteur » , souligne la Cour.
L’interdiction de cette grenade en 2017 n’a pas empêché d’autres armes similaires de rester en usage , comme les grenades GLI-F4 , toujours employées lors de manifestations.
« La France ne sort pas grandie de cette affaire »
La CEDH a également ordonné à l’État français de verser 50 700 euros d’indemnités à la famille de Rémi Fraisse. Une compensation financière qui ne saurait remplacer une condamnation pénale, estime les proches du jeune homme.« C’est une victoire et une confirmation de ce qui était pressenti depuis le début » , a réagi Me Claire Dujardin , avocate de la famille, auprès de l’AFP. « Le maintien de l’ordre à Sivens n’apportent pas les garanties suffisantes pour éviter que Rémi soit tué » , a-t-elle ajouté. Le père du militant, Jean-Pierre Fraisse , salue une décision qui reconnaît la responsabilité de l’État, mais déplore l’absence d’évolution sur la gestion des manifestations : « La France ne sort pas grandie de cette affaire. Elle le serait si elle mettait tout en œuvre pour que de tels faits ne se reproduisent pas. » De son côté, Me Patrice Spinosi , avocat du père, insiste sur les enseignements à tirer de cette condamnation : « Il aura fallu plus de dix ans pour que la responsabilité de l’État soit enfin reconnue. Pour éviter de nouvelles condamnations, la France doit maintenant revoir en profondeur sa politique de maintien de l’ordre », a-t-il réagi auprès de France Info.
C’est la première fois que la CEDH condamne la France pour la gestion du maintien de l’ordre en manifestation . Jusqu’ici, les condamnations européennes portaient essentiellement sur des techniques contestées, comme l’engagement des manifestants (les « nasses »), jugées disproportionnées en 2023. Cette fois-ci, la Cour met en cause l’encadrement global des forces de l’ordre et l’usage d’armes dit « intermédiaires » , longtemps défendues par les autorités malgré leurs risques pour l’intégrité physique des manifestants. Depuis plusieurs années , le Défenseur des droits alerte sur ces pratiques. En 2017, 2021 et 2023, il avait déjà pointé du doigt des violences excessives lors de manifestations comme Sainte-Soline (contre les mégabassines) ou sur le projet d’autoroute Castres-Toulouse . À chaque fois, l’État français a minimisé ces signaux. La CEDH envoie donc un signal fort : l’usage disproportionné de la force n’est plus acceptable sous prétexte de maintien de l’ordre. Reste à savoir si cette condamnation conduira à une réforme en profondeur des doctrines policières , ou si elle sera une simple condamnation symbolique.